
Histoire de l'écologie urbaine, principes, exemples

La écologie urbaine C'est une science qui est chargée d'étudier comment la partie sociale et la partie naturelle interagissent dans les zones peuplées. C'est un domaine d'étude qui part de l'écologie, mais qui est lié à d'autres domaines tels que la géographie ou la sociologie.
Son objectif principal est de déterminer comment les différentes communautés d'êtres vivants s'adaptent au contexte dans lequel elles vivent. Le développement de l'urbanisme ou l'impact provoqué par la création et la manipulation de matériaux considérés comme polluants sont pris en compte..

Actuellement, elle est classée comme l'une des sciences les plus importantes, car elle encourage la création de nouveaux espaces durables. De cette manière, il cherche à minimiser la réduction d'autres espèces avec le ferme objectif d'améliorer la qualité de vie. Entre autres, cette discipline parle de consommation responsable et de conservation.
Index des articles
- 1 Histoire
- 2 Impact
- 3 principes
- 3.1 L'écosystème
- 3.2 Hétérogénéité
- 3.3 Avec dynamisme
- 3.4 Liens
- 3.5 Processus écologiques
- 4 Expériences d'écologie urbaine en Amérique latine
- 4.1 À Bogotá, Colombie
- 4.2 La capitale écologique du Brésil
- 4.3 Projets au Chili
- 5 Références
Histoire
Pour parler d'écologie urbaine, il faut préciser un précédent très important, qui a été la naissance de l'écologie en tant que discipline. Cela s'est produit dans toute l'Europe et aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Cependant, les historiens ont même affirmé que le concept de vivre en équilibre avec la nature remonte à des temps aussi vieux que celui d'Aristote..
Les premières publications pertinentes axées sur le développement de l'écologie ont été celles qui ont marqué le début de cette nouvelle branche de la science. Au début, il avait même quelques détracteurs, en particulier l'écologie a été critiquée par les biologistes, mais elle a rapidement acquis une position de premier plan dans le domaine scientifique..
C'est entre les années 40 et 50 que les premières idées d'écologie urbaine ont commencé à se développer. Au cours des années précédentes, le terme avait déjà été utilisé pour désigner différentes choses. Par exemple, un groupe de sociologues a utilisé le terme «écologie urbaine» pour parler de leur travail à Chicago dans les années 1920..
C'est l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) qui a établi le point de départ de l'écologie urbaine. C'est arrivé quand il a soutenu financièrement la première étude sur l'écologie urbaine, en 1970..
Au fil des années, cette sous-discipline a su créer ses propres termes et méthodologies pour ses études. On s'attend à ce que dans un avenir pas si lointain, il continue à développer de nouvelles approches et à gagner en pertinence encore plus dans le monde scientifique..
Impacter
Les zones urbaines représentent moins de 5% des surfaces terrestres de la planète et seule la moitié de la population actuelle vit en zone urbaine. Malgré cela, les dégâts qu'ils font sont énormes.
Les constructions ont contribué à épuiser ou à endommager les ressources naturelles existantes, le même effet que certaines activités économiques des êtres humains qui ont été basées sur l'exploitation des ressources de la planète, dont beaucoup sont non renouvelables..
L'utilisation responsable de l'eau a été l'un des principaux objectifs de l'écologie urbaine, ainsi que la gestion des déchets ou l'utilisation correcte de l'énergie.
La pollution de l'atmosphère, des lacs et des océans, l'extinction de certaines espèces ou encore la prolifération d'autres sont quelques exemples de l'impact de l'urbanisme..
Début
En 2008, cinq principes ont été proposés sur lesquels reposait l'écologie urbaine. À cette époque, il était établi que les villes étaient des écosystèmes et qu'elles avaient plusieurs caractéristiques ou éléments qui les composent.
Les villes vivent également en constante évolution ou en évolution. Dans les villes, des événements de nature humaine et d'autres d'origine naturelle sont mis en évidence en même temps. Et comme dernier principe, il a été établi que l'écologie est toujours présente.
Au fil du temps, ces principes se sont développés et se précisent, afin de parler des différentes méthodologies présentes en écologie urbaine et aussi d'approfondir le lien entre les disciplines..
Ensuite, 13 normes ont été créées sur lesquelles repose l'écologie urbaine. Ces lois ont été chargées d'identifier les principaux points d'intérêt sur lesquels se concentre la science, ainsi que de créer des liens avec d'autres domaines de la connaissance. Ils aident à établir les façons d'agir.
Ces 13 principes sont également étroitement liés aux cinq exposés initialement en 2008 et parlent de différents aspects de l'écologie urbaine..
L'écosystème
Six des principes établis en écologie urbaine se réfèrent à l'écosystème. Par exemple, quand on dit que les villes sont des communautés d'organismes vivants en relation continue avec l'environnement physique dans lequel elles vivent..
En outre, il est établi que dans les zones urbaines, il y a aussi la présence de végétation et de ressources en eau. Un autre principe plonge dans la flore et la faune présentes dans ces zones et comment elles peuvent varier en fonction de la géographie dans laquelle elles se trouvent..
Hétérogénéité
Le principe le plus évident concerne la manière dont les zones urbaines sont constituées d'éléments de nature ou de nature différentes..
Avec dynamisme
Il a été établi que l'urbanisme et le développement des zones urbaines peuvent souvent être considérés comme des expériences écologiques.
Des liens
L'écoulement de l'eau est préoccupant, malgré le fait que plus de 70% de la planète est constituée de ce liquide. Les procédés de dessalement sont de plus en plus coûteux et c'est pourquoi un principe d'écologie urbaine fait référence à l'écoulement de l'eau.
Il a été convenu que l'approvisionnement de ce liquide est quelque chose qui inquiète tous les territoires urbanisés et qui à son tour relie chaque région les unes aux autres..
En outre, l'utilisation des terres et des ressources naturelles s'étend à d'autres zones à caractéristiques rurales, ce qui rend l'impact beaucoup plus large..
Processus écologiques
L'un des principes établit que dans les zones urbaines, il existe un processus continu de développement qui découle du contexte économique, social et même culturel dans lequel ils se produisent..
Expériences d'écologie urbaine en Amérique latine
Les communautés d'Amérique latine ont connu un exode important vers les zones urbaines où elles peuvent atteindre et profiter d'une meilleure qualité de vie. C'est dans les villes qu'il existe de meilleures voies de communication, un meilleur accès aux services de base, tels que l'eau et l'électricité, ainsi que de meilleures conditions sociales et économiques..
C'est pourquoi le développement des zones urbaines en Amérique latine a connu une croissance accélérée et également disproportionnée, dont les impacts ont également été négatifs à de nombreuses reprises..
On estime actuellement que plus de 80% des personnes qui vivent dans ces territoires se trouvent dans des zones urbanisées. Un nombre qui ne montre aucun signe de diminution ou de maintien, il a donc déjà été estimé que d'ici 30 ans, le chiffre augmentera encore de 10%.
Certains pays ont pris des mesures et créent des normes et standards qui doivent être respectés lors du développement des zones urbaines. C'est ainsi qu'est né le concept de ville durable, de sorte que la pollution et l'impact sur l'écosystème en général n'affectent pas négativement la qualité de vie d'aucune espèce..
À Bogota Colombie
À Bogotá, ils travaillent depuis 2014 sur un plan qui leur permet de protéger la végétation naturelle de la Colombie. L'idée consiste en la création d'un couloir qui sert à prendre soin des espèces existantes dans la réserve forestière Thomas van der Hammen.
Le travail n'a pas été facile. La zone est d'un grand intérêt pour le développement urbain de la ville, mais elle est également considérée comme le plus grand parc écologique d'Amérique latine.
Le maire de Bogotá, par exemple, souhaite construire des maisons sur ce territoire, ainsi que de nouvelles voies de communication reliant d'autres parties de la Colombie. Les marais ont beaucoup souffert de ce type de construction, ainsi que de l'exploitation minière.
Bogotá a également été un exemple très positif pour d'autres villes d'Amérique latine, puisque depuis 1999, elle a reçu de nombreux prix pour son développement urbain..
La capitale écologique du Brésil
L'une des villes du Brésil est connue comme la capitale écologique du pays. C'est le cas de Curitiba, où ils se sont efforcés d'éduquer leurs citoyens à être responsables vis-à-vis de l'environnement. Ils ont même une école où les connaissances sur les questions écologiques sont transmises aux communautés.
L'un des succès de Curitiba a été la création du programme La corbeille n'est pas une poubelle. Presque toute la population est consciente de l'importance du recyclage et ils ont même été récompensés pour leur contribution à l'environnement.
Projets au Chili
Dans des revues scientifiques, de nombreux cas sur l'écologie urbaine au Chili ont été exposés. Les impacts dans ce pays se sont fait ressentir notamment dans ses bassins et dans la diminution de certaines espèces typiques de l'écosystème chilien.
Le projet existe Couloirs verts qui vise à contribuer au développement de l'écologie urbaine dans le pays.
Les références
- Alberti, M. (2009). Progrès de l'écologie urbaine. New York: Springer.
- Gaston, K. (2010). Écologie urbaine. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marzluff, J. (2008). Écologie urbaine. New York, N.Y.: Springer Science + Business media.
- Niemelä, J., Breuste, J., Elmqvist Thomas, Guntenspergen Glenn, James Philip et McIntyre Nancy E. (2011). Écologie urbaine. Oxford.
- Steiner, F., et Forman, R. (2016). Écologie humaine. Washington: Island Press.

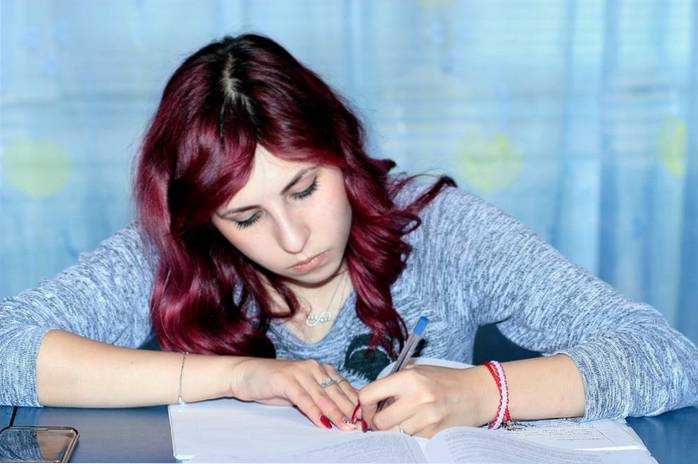

Personne n'a encore commenté ce post.