
Enterobacter cloacae caractéristiques, morphologie, maladies
Enterobacter cloacae est une bactérie Gram négatif en forme de bâtonnet appartenant à la famille des Enterobacteriaceae. Il est anérobie facultatif et mobile grâce à la présence de flagelles péritriches. Cette bactérie n'a ni capsule ni spores. Ne fermente pas le lactose et produit du gaz à la suite de la fermentation du glucose.
C'est une bactérie omniprésente dans la nature et peut être trouvée n'importe où, y compris l'eau pure et les déchets, le sol, ainsi que dans la flore intestinale de diverses espèces d'animaux (y compris les humains). Il fait partie d'un complexe d'espèces, qui porte son nom et auquel, à ce jour, six espèces ont été attribuées.

Enterobacter cloacae est un parasite opportuniste responsable de diverses infections d'origine intrahospitalière (nosocomiale), y compris des infections des voies urinaires, des voies respiratoires, des péritonites ou des bactériémies, entre autres.
Le traitement de ces maladies est compliqué, car les bactéries présentent une résistance (naturelle ou acquise) à de nombreux médicaments, dont les céphalosporines de troisième génération et les carboxy-pénicillines..
Index des articles
- 1 Caractéristiques générales
- 2 Morphologie
- 3 Taxonomie
- 4 Espèces du complexe Enterobacter cloacae
- 4.1 Enterobacter asburiae
- 4.2 Enterobacter cloacae
- 4.3 Enterobacter hormaechei
- 4.4 Enterobacter kobei
- 4.5 Enterobacter ludwigii
- 4.6 Enterobacter nimipressuralis
- 5 Cycle de vie
- 6 Maladies
- 7 Symptômes
- 8 traitements
- 9 Références
Caractéristiques générales
Enterobacter cloacae C'est un bâtonnet Gram négatif qui, comme les autres membres de la famille, est anaérobie facultatif, il teste positif pour la catalase, le citrate et l'uréase; alors qu'il est négatif pour l'indole, l'oxydase et la DNase. Il ne décarboxyle pas la lysine, mais il décarboxylate l'ornithine. En plus de cela, il réduit les nitrites et fermente le glucose..
Des tests plus spécifiques à l'espèce montrent un résultat variable avec l'esculine, alors qu'il est positif pour le D-sorbitol, l'arginine dihydrolase et pour la réaction de Voges-Proskauer et négatif pour le dulcitol..
Entre autres caractéristiques de l'espèce, les chercheurs soulignent qu'il s'agit d'un micro-organisme mobile qui ne sporule pas et est capable de former des biofilms, ce qui favorise sa capacité à coloniser différents dispositifs hospitaliers..
Cette bactérie possède une résistance naturelle aux antibiotiques en raison de sa capacité à surproduire les β-lactamases AmpC en déverrouillant les gènes chromosomiques, ainsi qu'en raison de sa capacité à acquérir des gènes AMP transférables à partir de plasmides..
En l'absence totale d'oxygène Enterobacter cloacae est capable de réduire le sélénite en sélénium.
Morphologie
Enterobacter cloacae est une bactérie allongée en forme de bâtonnet d'une taille allant de 0,8 à 2,0 μm et de 0,3 à 0,6 μm.
Il n'a pas de capsule, sa paroi est constituée de deux membranes cellulaires. Le lipide-A du lipopolysaccharide de la première membrane, ou endotoxine, est capable de provoquer la libération de cytokines et de provoquer une septicémie.
Cette espèce est mobile en raison de la présence de flagelles péritriches. Ce sont des flagelles qui sont répartis sur toute la surface de la bactérie.
La colonie présente une coloration rose lorsqu'elle est cultivée sur gélose McConkey..
Il a un chromosome individuel et circulaire et son génome est composé d'environ 5,5 Mb, les plasmides peuvent ou non être présents selon la souche.
Taxonomie
Enterobacter cloacae est une Proteobacteria appartenant à la classe Gammaproteobacteria, à l'ordre des Enterobacteriales, à la famille et au genre Enterobacteriacea Enterobacter. Ce genre a été décrit à l'origine par Hormaeche et Edwards en 1960, et compte actuellement 22 espèces, dont E. cloacae.
Enterobacter cloacae, pour sa part, il a été décrit pour la première fois par la Jordanie en 1890 comme Bacillus cloacae et a une synonymie étendue. Il a été inclus dans le genre Enterobacter par Hormaeche et Edwards, et a deux sous-espèces: E. cloacae cloacae Oui E. cloacae dissout.
De plus, il appartient à un complexe d'espèces qui contient cinq autres espèces, dont Enterobacter hormaechei, qui à son tour a trois sous-espèces.
Espèces complexes Enterobacter cloacae
Enterobacter asburiae
Taxon érigé en 1986 en hommage à la bactériologiste nord-américaine Mary Alyce Fife-Asbury, qui a décrit de nouveaux sérotypes de Klebsiella Oui Salmonella, ainsi que de nouveaux genres et de nouvelles espèces de bactéries. Les chercheurs ont isolé cette espèce du sol et des hôtes humains.
Enterobacter cloacae
Cette espèce est une partie commune de la microflore intestinale de l'homme et de nombreuses espèces animales, c'est aussi un pathogène opportuniste responsable de diverses maladies nosocomiales.
Enterobacter hormaechei
Taxon érigé en hommage à Estenio Hormaeche, un microbiologiste uruguayen qui, avec PR Edwards, a décrit le genre Enterobacter. Cette espèce a trois sous-espèces différentes qui ne peuvent être différenciées entre elles qu'en fonction de leurs propriétés particulières, ainsi que des tests biochimiques. C'est un pathogène nosocomial important.
Enterobacter Kobei
Espèce baptisée en hommage à la ville de Kobe au Japon, où elle a été isolée pour la première fois. Il diffère du reste des espèces du complexe en donnant un résultat négatif au test de Voges-Proskauer..
Enterobacter ludwigii
Espèce qui tire son nom de Wolfgang Ludwig, célèbre bactériologiste responsable du projet dit ARB, qui permet de traiter l'information génétique de différents organismes et d'en faire des arbres phylogénétiques. Cette espèce diffère de E. cloacae dans lequel le test est négatif pour le saccharose et le raffinose.
Enterobacter nimipressuralis
Espèce très similaire à E. cloacae, mais contrairement à celui-ci, il donne des tests négatifs pour le saccharose et le raffinose.

Cycle de vie
Enterobacter cloacae c'est un parasite opportuniste, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un hôte pour terminer son cycle de vie. En dehors de l'hôte, il peut vivre sur le sol ou dans l'eau.
Dans n'importe lequel de ces environnements, il se reproduit par fission binaire, qui est un type de reproduction asexuée qui consiste en la duplication du matériel génétique, l'élongation de la cellule et la formation d'un septum qui sépare deux cellules filles de la cellule. Parent.
Maladies
Enterobacter cloacae Il fait partie de la flore intestinale normale de l'être humain, où il vit sans causer de dommages apparents. Cependant, c'est un pathogène opportuniste qui peut provoquer de nombreuses maladies, principalement chez les personnes dont le système immunitaire est déprimé..
Cette espèce est devenue ces dernières années l'une des principales causes de maladies acquises dans les centres de santé (maladies nosocomiales), du fait de sa résistance, naturelle ou acquise, à de nombreux antibiotiques utiles pour agir contre d'autres bactéries..
Un autre facteur qui a favorisé E. cloacae est devenu un pathogène émergent est sa capacité à former des biofilms qui lui permet de coloniser différents appareils à usage hospitalier, tels que cathéters, stéthoscopes, thermomètres numériques, produits sanguins, entre autres.
Maladies causées par E. cloacae Ils ne sont pas spécifiques à cette bactérie, mais peuvent être produits par différents agents pathogènes, pour lesquels il est nécessaire de réaliser différents tests de laboratoire pour confirmer leur responsabilité dans chaque cas..
Ces maladies comprennent la présence de bactéries dans le sang (bactériémie), des infections des yeux, des voies respiratoires inférieures, de la peau, des tissus mous ainsi que des infections intra-abdominales. Il est également responsable de l'endocardite, de l'arthrite septique et de l'inflammation des os (ostéomyélite)..
Ces maladies ont des niveaux élevés de morbidité et de mortalité et sont également compliquées en raison de la résistance des bactéries à plusieurs antibiotiques..
Les chercheurs ont également déterminé qu'il existe une relation entre l'obésité et la présence de Enterobacter cloacae, au moins dans les tests de laboratoire avec des souris.
Symptômes
Comme nous l'avons déjà souligné, Enterobacter cloacae est responsable de différentes maladies, qui peuvent avoir différents niveaux de danger et qui présenteront des symptômes différents.
Les infections de la vessie et des voies urinaires peuvent provoquer une douleur intense ou une sensation de brûlure pendant la miction, une diminution du débit urinaire, de la pression et une envie d'uriner très fréquemment, ainsi qu'une sensation de ne pas avoir complètement uriné..
Les infections des voies respiratoires inférieures se manifestent par des mucosités jaunes, une sensation d'essoufflement, de la fièvre et une toux sévère. La bactérie peut provoquer une pneumonie, qui présente des symptômes moins graves que d'autres types de pneumonie, mais des taux de mortalité plus élevés.
Les infections de la peau et des tissus mous sont, après les maladies respiratoires molles, les formes les plus courantes d'infections bactériennes chez l'homme. Selon la gravité du cas, les symptômes peuvent inclure une inflammation, de la fièvre, une hypothermie, une hypotension, une hyperglycémie et même une confusion mentale.
L'endocardite provoque des souffles cardiaques, une toux sévère, de la fièvre, une sensation de fatigue, une hématurie et une insuffisance circulatoire. De son côté, l'arthrite due à Enterobacter cloacae produit une douleur intense dans la zone touchée, transpiration, froid, entre autres.
Traitements
Traitement des infections causées par Enterobacter cloacae il est compliqué en raison de la résistance des bactéries à de multiples antibiotiques. La principale cause de la résistance de E. cloacae aux antibiotiques est due à la présence de β-lactamases de type AmpC. Vous pouvez également acquérir des gènes de résistance à partir de plasmides.
Les Β-lactamases confèrent E. cloacae résistance naturelle aux aminopénicillines, aux céphalosporines de première génération et à la céfoxitine, ainsi qu'une sensibilité variable aux céphalosporines de troisième et quatrième générations.
Les carbapénèmes étaient généralement la première option thérapeutique dans les infections causées par cette bactérie, car la présence de carbapénèmes était rare. Cependant, au cours des dernières décennies, ils sont devenus plus fréquents, augmentant leur résistance à ces médicaments et rendant le traitement difficile..
Un traitement alternatif lorsque la résistance aux carbapénèmes apparaît est l'utilisation de l'amikacine, qui est efficace dans la plupart des cas. Cependant, des chercheurs ont récemment trouvé des souches résistantes à ce médicament dans un hôpital de Bogotá, en Colombie..
Outre l'amikacine (à laquelle 95% des souches ont montré une résistance), elles ont également montré une résistance plus ou moins grande au céfotaxime, à la ceftazidime, à la ceftriaxone, à l'aztréonam, à la ciprofloxacine, à la gentamicine, au chloramphénicol, au triméthoprime / sulfaméthoxazole et au céfépime. Examinez que tous étaient sensibles à l'imipénème.
Les références
- M.L. Mezzatesta, F. Gona et S. Stefani (2012). Complexe Enterobacter cloacae: impact clinique et résistance émergente aux antibiotiques. Microbiologie future.
- F. Silva, T.M.P. Martínez (2018). Complexe Enterobacter cloacae. Journal chilien d'infectologie.
- Enterobacter cloacae. Sur Wikipedia. Récupéré de: en.wikipedia.org.
- Techne. Enterobacter cloacae. Quantification des génomes d'Enterobacter cloacae. 1 manuel du kit avancé.
- Bactérie Enterobacter cloacae. Récupéré de: scribb.com.
- Test biochimique et identification de Enterobacter cloacae. Récupéré de: microbiologyinfo.com.
- S, Octavia et R. Lan (2014). La famille des entérobactéries. Dans E. Rosenberg et al. (éd.), The Prokaryotes - Gammaproteobacteria, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

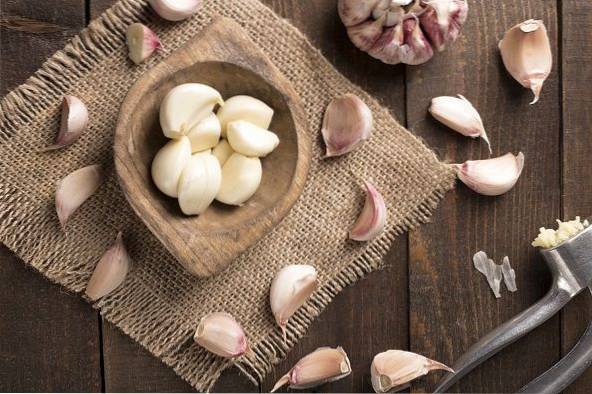

Personne n'a encore commenté ce post.