
Cornéocytes caractéristiques, histologie, fonctions
Les cornéocytes, ou kératinocytes anucléés, ce sont des cellules squameuses, aplaties et sans noyau qui constituent l'élément fondamental de la barrière cutanée, les cellules épidermiques étant les plus différenciées.
Les cornéocytes constituent ensemble la couche cornée "stratum corneum", Couche de l'épiderme métaboliquement inactive ou morte. Toutes les couches épidermiques constituent l'épithélium plat kératinisé caractéristique de la peau.

Les cellules cornées de l'épiderme représentent la dernière phase de kératinisation de la membrane basale ou germinale (kératinocytes). Ces cellules ont une forte enveloppe cornéenne et un cytoplasme fibrillaire très réduit, plein de kératine et sans présence d'organites cellulaires..
Index des articles
- 1 Caractéristiques générales
- 1.1 Processus de kératinisation
- 1.2 Formation de cornéocytes
- 1.3 Desquamation du cornéocyte
- 2 Histologie
- 3 fonctions
- 3.1 Stratum corneum et traitements topiques
- 4 Références
Caractéristiques générales
La peau, structurellement parlant, est une barrière efficace entre l'extérieur et l'intérieur du corps. De cette manière, une barrière «interne» est créée pour empêcher l'évaporation et une barrière «externe» contre les effets mécaniques, chimiques et microbiens de l'environnement..
L'objectif principal du processus de différenciation de l'épiderme chez les mammifères est de générer une couche externe cornée relativement imperméable. Ce processus est considéré comme une forme spécialisée d'apoptose dont le produit final est une cellule presque entièrement kératinisée..
Afin de remplir ces fonctions, un processus de kératinisation ou de maturation cellulaire se produit à partir des cellules présentes dans la couche proliférative (basale) à fort potentiel mitotique jusqu'aux écailles superficielles de la couche cornéenne..
Les cornéocytes sont des kératinocytes assez différenciés en raison du processus de cornification. Au cours de ce processus, l'objectif est de former une membrane résistante, imperméable et en constante évolution. La disposition des cornéocytes dans la strate squameuse est également connue sous le nom de "en briques et mortier".
Ces cellules squameuses se renouvellent rapidement, ce qui implique un remplacement complet de la couche cornée dans un intervalle de temps qui va d'environ 15 à 30 jours dans une peau sans problèmes..
Processus de kératinisation
En général, la cellule basale épidermique commence à synthétiser des filaments de kératine intermédiaires qui se concentrent et forment des tonofibrilles. Cette cellule pénètre ensuite dans la couche épineuse, où se poursuit la synthèse des filaments intermédiaires de kératine.
Dans la partie superficielle de cette couche, commence la production de granules de kératohyaline. Ceux-ci contiennent des protéines telles que la filaggrine et la trichohyaline associées à des filaments intermédiaires, ainsi que des corps lamellaires avec des glycolipides..
Déjà dans la couche granuleuse, la cellule expulse les corps laminaires qui contribuent à la formation d'une barrière d'eau dans la couche cornée.
Le reste du cytoplasme du kératinocyte granulaire contient d'abondants granules de kératohyaline qui sont profondément associés aux tonofilaments, formant l'enveloppe cellulaire. L'existence de ces granules est la preuve d'une kératinisation cellulaire.
Une augmentation de la concentration de calcium dans la couche granulaire provoque la libération du contenu des granules de kératohyaline. De cette manière, la profilaggrine qui est convertie en monomères actifs de filaggrine, se lie aux filaments intermédiaires de kératine, en les agrégeant et en les compactant, ce qui provoque l'affaissement de la cellule à sa forme plate..
Le processus de migration de la cellule de la couche granuleuse vers la couche cornée dure environ 6 heures.
Formation de cornéocytes
La transformation de la cellule granulaire en cornifiée comprend la destruction du noyau et de tous les organites cellulaires, ainsi qu'un épaississement important de la membrane et une diminution du pH dans cette strate.
Les cellules de la couche cornée sont appauvries en lipides et sont à leur tour noyées dans un interstitium riche en lipides neutres, constituant une barrière efficace contre l'eau. Les lipides neutres fonctionnent comme un ciment disposé en bicouches laminaires entre les cornéocytes et proviennent des corps lamellaires libérés dans la couche granulaire.
Les cornéocytes sont fortement liés entre eux par des cornéodesmosomes et sont recouverts d'une enveloppe cellulaire cornifiée, qui a une partie protéique produite par la production de protéines structurales (jusqu'à 85%) et une autre partie lipidique, qui fournit une résistance mécanique et chimique..
Bien que le rôle de tant de lipides ne soit pas exactement connu, on pense qu'ils participent à la modulation de la perméabilité de la peau. Ils représentent également un lien pour l'organisation de la cohésion des cornéocytes et la desquamation de la couche cornée..
Au cours du processus de cornification, une grande partie des lipides (comme les sphingolipides) disparaît et est remplacée par l'accumulation de stérols libres et estérifiés.
Desquamation du cornéocyte
La desquamation ou exfoliation superficielle de la couche squameuse est essentiellement un processus protéolytique régulé. Ce dernier consiste en la dégradation des cornéodesmosomes des cellules cornéennes, qui se produit à partir de l'action des sérine peptidases liées à la kallikréine telles que KLK5, KLK7 et KLK14.
Au fur et à mesure que le pH diminue suite à la dégradation de la filaggrine par différentes protéases et à la libération d'acides aminés dans les couches superficielles de l'épiderme, ces protéines (KLK) sont libérées qui dégradent les desmosomes entre les cellules, permettant l'exfoliation des cellules. eux-mêmes. Cela permet un renouvellement contrôlé de la peau à partir du gradient de pH existant.
Histologie
La couche cornée est constituée de plusieurs couches de cornéocytes, qui ont une épaisseur variable selon la région anatomique comprise entre 10 et 50 µm. L'épaisseur a tendance à être minimale dans les régions muqueuses (peau fine) et maximale dans la plante des pieds, les paumes des pieds et des mains, les coudes et les genoux (peau épaisse).
Les cornéocytes sont constitués de 40% de protéines, 20% de lipides et d'eau (environ 40%). L'enveloppe des cellules cornéocytaires contient 15 nm de protéines insolubles telles que la cystaïne, les protéines desmosomales, la filaggrine, l'involucrine ou 5 chaînes kératiniques différentes, entre autres..
L'enveloppe lipidique est constituée d'une couche de lipides de 5 nm liés par des liaisons de type ester, les principaux composants étant les sphingolipides (céramides), le cholestérol et les acides gras libres, étant des molécules d'acylglucosylcéramide de grande importance..
La couche cornée présente de petites altérations autour des follicules pileux, où seule la partie supérieure de l'appareil folliculaire (acroinfundibulum) est protégée par une couche cornée cohérente. En revanche, dans la partie inférieure (infrainfundibulum), les cornéocytes semblent indifférenciés et la protection est incomplète ou absente..
Pour cette raison, les régions précitées constituent une cible pharmacologique pour la peau, puisque même les particules solides peuvent entrer par la voie folliculaire..
Caractéristiques
La principale barrière physique entre l'environnement externe et l'environnement interne est essentiellement constituée par la couche cornée. Avec les couches internes, ils protègent le corps de divers facteurs participant au maintien de l'homéostasie corporelle..
La couche cornée représente la barrière physique elle-même, tandis que les strates suivantes (épiderme à cellules nucléées) constituent les barrières chimiques. Plus précisément, il empêche l'entrée de substances nocives, la perte de liquides et l'accumulation excessive de bactéries à la surface de la peau.
De plus, ils ont une forte membrane cytoplasmique cornifiée revêtue à l'extérieur de divers composés lipidiques qui forment le composant principal pour repousser l'eau. Cette dernière est déterminée par le dépôt de protéines insolubles sur la surface interne de la membrane et d'une couche de lipides qui se consolident sur la surface externe..
Stratum corneum et traitements topiques
La couche cornée est également une barrière très efficace à l'entrée de médicaments. Dans certains traitements dermatologiques, les voies d'entrée de ces sujets peuvent se faire par plusieurs voies, l'une d'entre elles étant l'entrée par les cornéocytes (voie transcellulaire), qui dépendra de la taille des cornéocytes et est la voie la plus importante.
Plus les cornéocytes sont gros, plus le coefficient de diffusion est faible. Cependant, sachant que la couche cornée est lipophile, les médicaments liposolubles sont plus faciles à traverser.
En revanche, les médicaments peuvent pénétrer par les espaces intercornocytaires qui ne représentent que 5% du volume de la couche cornéenne, leur participation à l'absorption est donc minime. Et une troisième voie est à travers les phanères cutanées dont l'absorption est encore plus faible..
Les références
- Alam, M. (2004). La dermatologie de Fitzpatrick en médecine générale. Archives de dermatologie, 140(3), 372-372.
- Armengot-Carbo, M., Hernández-Martín, Á., Et Torrelo, A. (2015). Filaggrine: rôle dans la barrière cutanée et dans le développement de la pathologie. Actas dermo-sifiliographiques, 106(2), 86-95.
- Avril, M. (2004). Soleil et peau: bénéfices, risques et prévention. Elsevier Espagne.
- García-Delgado, R., Travesedo, E. E. et Romero, A. S. (2004). Utilisation rationnelle des médicaments topiques en dermatologie. Médecine de la peau ibéro-latino-américaine, 32(1), 39-44.
- Marks, R. et Plewig, G. (éd.). (2012). Stratum corneum. Springer Science & Business Media.
- Ross, M. H. et Pawlina, W. (2007). Histologie. Atlas de texte et de couleur avec biologie cellulaire et moléculaire. Éditorial Médica Panamericana 5e édition.
- Toro, G. R. (2004). Glossaire illustré de dermatologie et dermatopathologie. Université nationale de Colombie.
- .
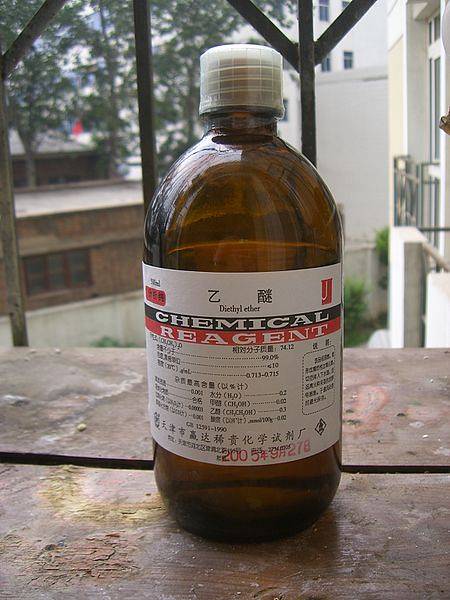

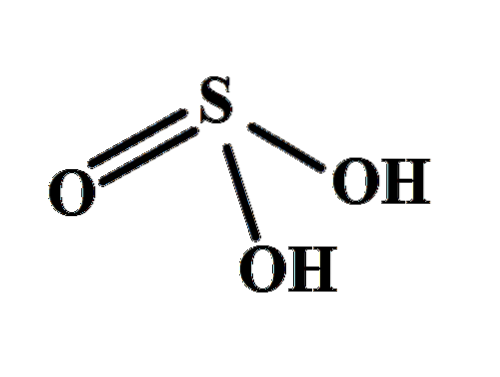
Personne n'a encore commenté ce post.